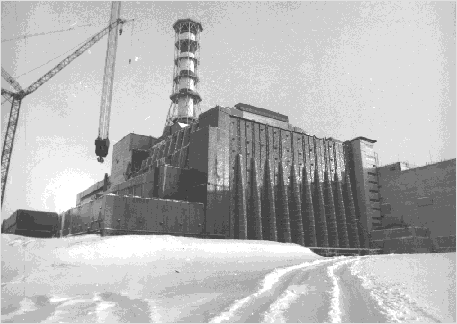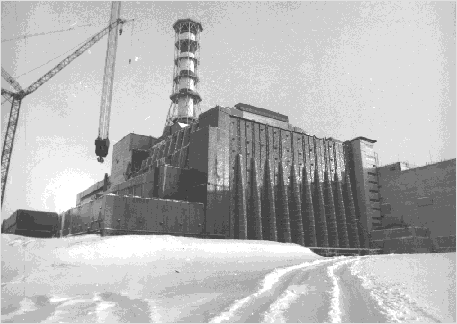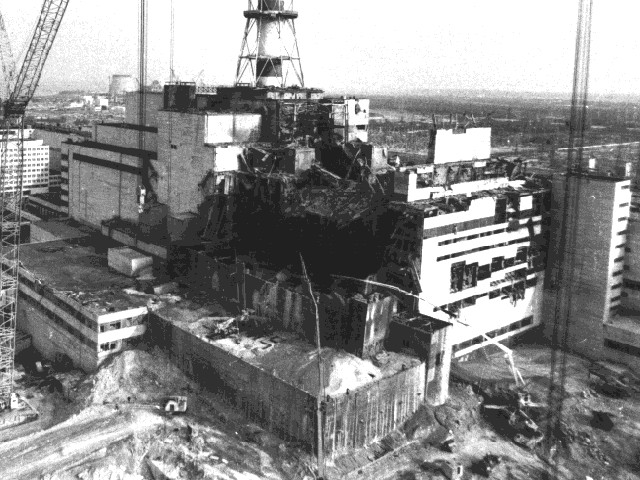Historique Tchernobyl
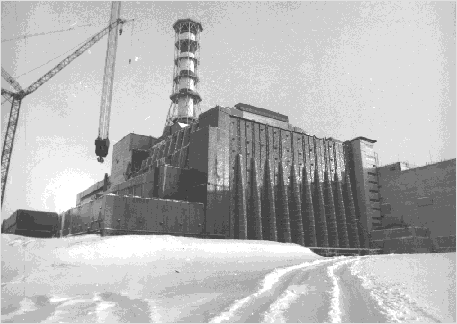
Il s'agissait au départ de faire une expérience pour
améliorer la sécurité.
Après déconnexion du système d'arrêt d'urgence du réacteur pour
qu'il n'intervienne pas intempestivement pendant les phases décisives,
l'expérience pouvait commencer aux premières heures du vendredi 25
avril 1986. Un bouton avait été ajouté au tableau de commande pour
déclencher manuellement l'arrêt "imprévu" du réacteur et la prise de
relais électrique de la ligne d'arbre turboalternateur; ce
déclenchement était prévu dans les premières heures du 26 avril.
Dès le début de l'après-midi du 25, la puissance thermique avait
été réduite progressivement à 1 600 mégawatts et l'un
des deux turboalternateurs de 500 mégawatts électriques
découplé du réseau. À ce moment le centre de répartition de la
production électrique de Kiev a demandé à la tranche 4 de Tchernobyl
une fourniture de courant imprévue, ce qui a conduit à stopper la
baisse de puissance de 14 à 23 heures. Cette demande aurait
dû être refusée, car elle perturbait le déroulement programmé et
allait contribuer à augmenter l'empoisonnement au xénon qu'il
faudrait compenser en extrayant progressivement les barres de
contrôle. De plus, le circuit de refroidissement de secours
avait été découplé depuis 14 heures sans qu'on connaisse
la raison de cette
décision et de son non-réenclenchement (un oubli des opérateurs?).
À 23 heures la baisse de puissance reprend; à minuit, sont atteints
les 700 mégawatts, limite basse imposée. Le 26,
à 0 h 30, il était prévu de passer d'un système
de régulation automatique à un système manuel, mais
l'opération se déroule mal, la puissance tombe à 30
mégawatts. Il semble que, pendant cette période, il y ait
eu désaccord entre les opérateurs qui étaient tenus de
respecter des consignes de baisse de puissance très progressive
et l'envoyé de Moscou. Une première tentative de baisse des
barres ayant échoué, ce dernier a interdit une seconde tentative
qui aurait peut-être permis d'éviter une aggravation de
la situation.
Entre 0 h 30 et 1 heure, la
puissance put être stabilisée à 200 mégawatts, mais
au prix d'une nouvelle extraction de barres de contrôle;
on était alors bien au-dessous du minimum de barres à maintenir
dans le coeur, avec une puissance encore bien inférieure à la
limite de 700 mégawatts prescrite.
Le réacteur est alors en plein domaine d'instabilité, interdit
d'accès par les constructeurs selon les critères de puissance
et du nombre de barres de contrôle insérées. Les intervenants,
sans doute inconscients de la gravité des risques encourus,
poursuivent l'expérience en appliquant les consignes qui
avaient été définies dans l'hypothèse d'un fonctionnement
à l'intérieur du domaine de stabilité. Ils remettent en route -
comme prévu par le programme non perturbé - les deux dernières
pompes de circulation, créant ainsi un refroidissement dangereusement
surabondant, et ignorent les signaux d'arrêt d'urgence que provoque
cette décision.
Entre 1 h 21 min 30 s et 1 h 23 min, les événements
se précipitent. Les vannes d'admission de la vapeur à la turbine
sont fermées. Les quatre pompes principales fonctionnent sur
l'inertie de l'arbre turboalternateur mais ralentissent
progressivement; le réacteur est toujours en marche, l'eau
chauffe, se vaporise, la réactivité s'accélère.
À 1 h 23 min 40 s, le chef opérateur fait enfin chuter
toutes les barres de contrôle et de sécurité, mais leur structure
est telle que, dans la première phase d'introduction,
un cylindre en graphite précède la partie absorbante,
de sorte que l'eau, qui avait un rôle modérateur, est
chassée, ce qui provoque, sur 1,25 m de chute, une montée
brutale de réactivité qui dure de 3 à 4 secondes car
les barres, très lentes, mettent 18 secondes pour chuter.
Cette excursion d'énergie est sans doute à l'origine de la
première explosion perçue par les opérateurs.
Au-delà de cet instant, les phénomènes destructeurs se sont
succédés et des scénarios divers ont été imaginés a posteriori
d'après l'examen des débris du réacteur. Un fort dégagement
d'énergie chimique entre les combustibles rompus et l'eau explique
le soulèvement de la dalle supérieure du réacteur qui est retombée
sur la tranche. Une forte déflagration perçue ensuite peut
provenir soit d'une réaction libérant l'hydrogène - de
l'eau décomposée au contact des gaines en zirconium surchauffées
du combustible -, soit de la détente de la vapeur à 70
bars lors de la rupture des tubes de force. Enfin, le graphite
irradié est le siège d'une accumulation d'énergie, l'effet Wigner;
la libération de cette énergie pourrait être à l'origine des
feux de graphite qui ont persisté plusieurs jours et contribué
à la dispersion de la radioactivité dans le nuage s'échappant
de la centrale détruite. On a aussi émis l'hypothèse d'une fusion
des barres de sécurité qui se seraient coincées avant d'achever
leur chute.
C'est ainsi qu'une expérience visant à améliorer la sûreté d'un
réacteur s'est terminée en catastrophe.
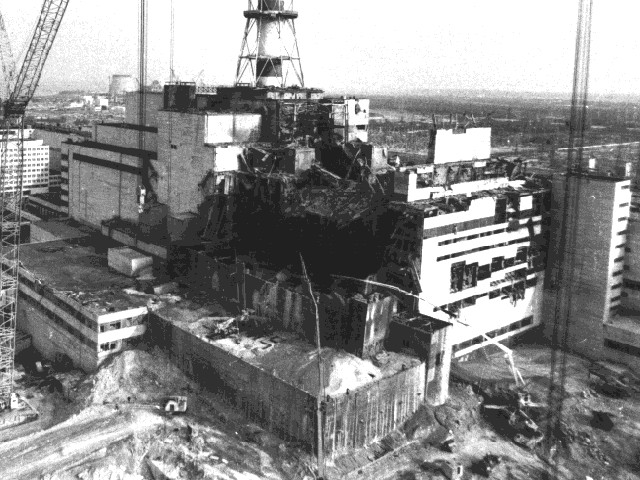
 précédent précédent
|
Accueil
|